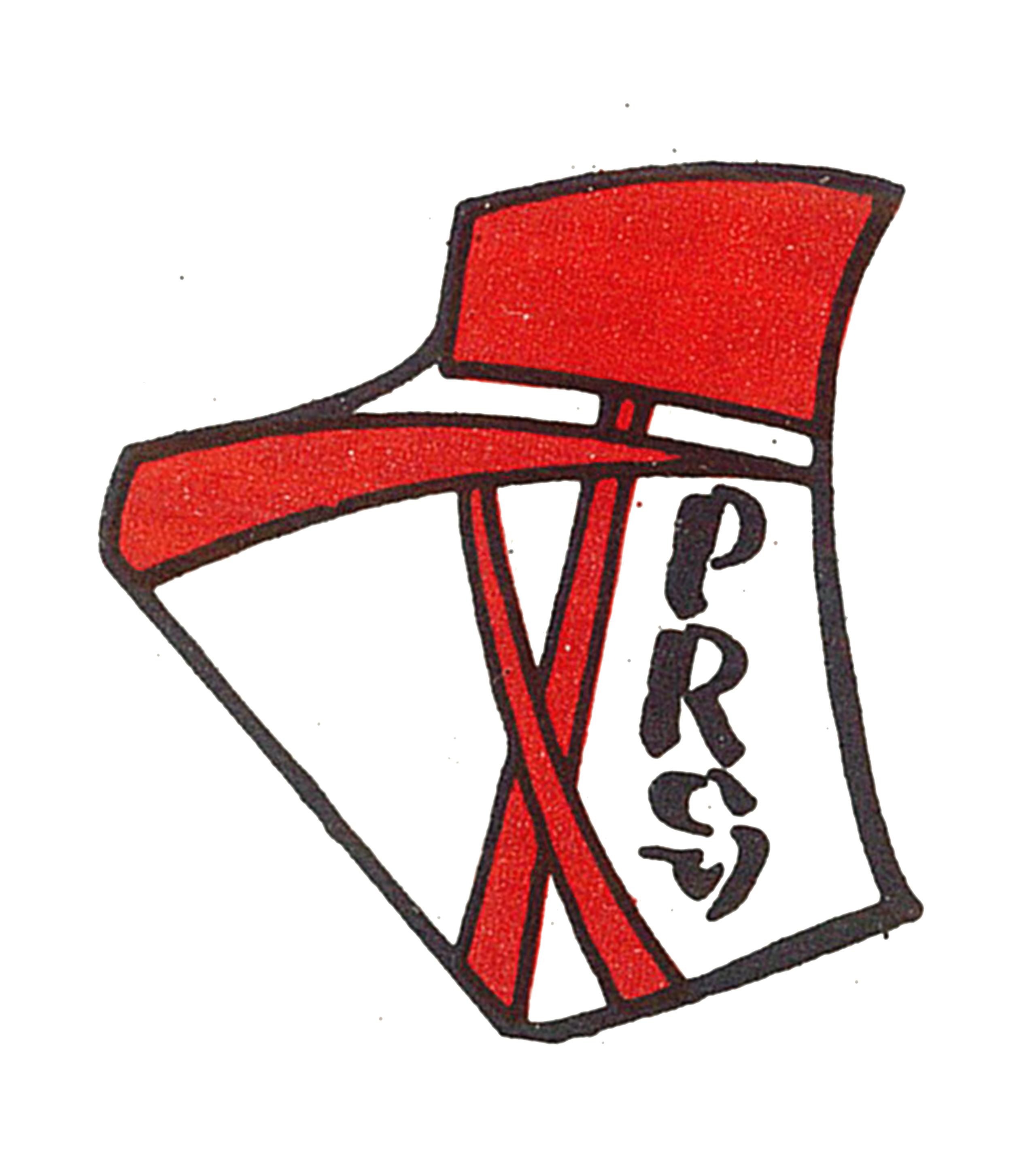A propos du Parti de la révolution socialiste (PRS)
Dans un article publié dans El Jarida n°7 du 20 septembre 1969, le PRS saisit l’occasion de son 7ème anniversaire pour se pencher sur son histoire et tenter de synthétiser ses positions :
Sept années d’expériences et de luttes qui ont façonné le Parti de la Révolution Socialiste
Le PRS a toujours tenté d’éviter la facilité. Il s’est souvent penché sur le chemin déjà parcouru afin de critiquer les expériences passées, bonnes ou mauvaises, et d’en tirer les leçons. Seul moyen d’aller de l’avant et auquel le PRS doit, sans doute, d’être toujours bien vivant après sept années d’existence alors que tous les mouvements politiques algériens de la même époque dans le pouvoir et hors du pouvoir, ont été emportés par le tourbillon de l’histoire.
Si le PRS a été capable de « retomber sur ses pieds », malgré certains moments difficiles, c’es t parce que dès le début, on retrouve certaines constantes auxquelles il s’est toujours raccroché et en premier lieu la conviction inébranlable en l’inéluctabilité de la révolution socialiste dans notre pays… Tout aussi forte est sa confiance dans la capacité des masses algériennes à prendre leur sort en mains et à faire la révolution.
C’est aussi à l’énergie farouche de ses militants, qui contre vents et marées ont conservé le cap, que le P.R.S. doit de s’être maintenu et d’avoir progressé.
L’histoire du Parti n’est pas continue et progressive, elle se présente sous une succession de discussions, de réajustements, de luttes idéologiques, dont le résultat a été chaque fois d’en renforcer le caractère socialiste et prolétarien et d’en éliminer les aspects petit-bourgeois. Mais eu fur et à mesure qu’il précisait son contenu, le PRS s’épurait. Ces décantations successives l’ont rudement façonné et ont contribué à lui donner son visage actuel.
1- La dualité du PRS à ses début
Avant même sa création officielle le 20 septembre 1962, le PRS vit sa première crise et connait sa première épuration. Au lendemain de la victoire du clan de Tlemcen et de l’installation du « Bureau Politique » à Alger, nombreux étaient les mécontents qui voulaient faire quelque chose. Aussi, quand les premiers travaux en vue de la création du P.R.S, eurent lieu, il fut difficile de faire un tri sérieux parmi les éléments qui affluaient, personnalités, ex-dirigeants, fractions de féodalités, revanchards aigris, tous ceux qui ne croyaient pas en Ben Bella ou qui avaient été éliminés par lui, et qui pensaient utiliser le PRS et Mohamed Boudiaf pour retrouver rapidement une place dans l’appareil d’Etat et prendre leur part du gâteau.
Fort heureusement, à la veille de la proclamation du 20 septembre, jour des élections à « l’Assemblée », la décision fut prise que les futurs parlementaires qui voulaient participer à la création du PRS devaient retirer leurs candidatures ; le problème fut vite réglé, un seul retrait fut annoncé à la presse, celui de Boudiaf. Les autres préférèrent siéger à l’Assemblée et travailler de l’intérieur à la transformation du régime.
Débarrassé de certaines personnes, le PRS n’en était pas pour autant quitte. Les idées qui les avaient animés, leur survivaient.
– Pour un noyau de militants du PRS le problème était clair et se résumait ainsi : le FLN étant arrivé au bout de sa course, il ne peut édifier l’Algérie indépendante au profit des masses populaires, bien au contraire, il est devenu un instrument aux mains de la petite bourgeoisie bureaucratique pour asseoir sa domination sur le peuple ; la seule réponse digne de révolutionnaires est alors de rejeter le FLN, de refuser le Parti unique et de créer un Parti de classe capable de poursuivre la révolution jusqu’à la fin de l’exploitation de l’homme par l’homme.
– Pour d’autres, le PRS était une opposition à Ben Bella et à l’Etat Major de l’ANP et son but était de constituer rapidement une force capable de balayer le pouvoir. Cette tendance bien que diffuse s’exprimait surtout dans certains thèmes, celui de la nécessité du regroupement des éléments « sains » (récupération des anciens cadres du FLN-ALN) et dans celui de l’illégitimité du pouvoir de Ben Bella. Mais c’est dans une pratique entièrement tournée vers le travail de sommet et non vers les masses, et dans l’absence de structures de travail adéquates que se reflétait cette orientation, alors très répandue.
Cette dualité du PRS à ses débuts, se retrouve aussi dans une certaine ambiguïté des formulations, d’où la faiblesse de certaines analyses (armée-wilayas), dans une forme d’autocensure dont on retrouve des traces dans la plupart des textes de l’époque. Il faut pourtant souligner que, d’une façon générale, les textes du PRS. du 20 septembre 1962 à l’été 1963 restent très nets sur l’essentiel et apportent une contribution décisive à la vulgarisation des idées du socialisme, de l’analyse des classes sociales, de la nécessité d’un Parti des travailleurs.
Peu à peu cependant, le PRS s’épure des éléments les plus hésitants qui préfèrent prendre le train du Benbellisme en marche plutôt que de tout perdre. Le noyau initial se restreint, mais en même temps il se durcit et des percées sont faites sur les milieux ouvriers : Union générale des travailleurs algériens (UGTA). Autogestion, émigration.
Les positions théoriques se précisent : le P.R.S. doit se démarquer entièrement du pouvoir (condamnation de l’entrisme), il doit défendre en toutes circonstances les intérêts des masses (action au moment du congrée de l’UGTA, action au niveau de l’animation de l’autogestion, publication dans « P.R.S. Information », des doléances populaires de tous les coins du pays}, il doit s’engager fermement dans un processus de longue haleine qui amènera la construction d’un Parti d’avant- garde. Les tâches étaient alors fixées dans la formule : « Former, informer, animer ».
Mais, dans la pratique les frontières sont plus diffuses, l’opposition est plus diluée, aussi le PRS omet-il de dénoncer les manœuvres de certains opposants, le comportement politique opportuniste de certains dirigeants, il refuse de polémiquer avec la soi-disant gauche du FLN qui, pratiquant l’entrisme à large échelle, contribue pour une grande part à créer le mythe du socialisme benbelllste. Confinant son action dans de sourdes luttes d’appareil, cette fraction dé la petite bourgeoisie bureaucratique avait pour rôle de démobiliser les masses par des slogans mystificateurs, de diviser les travailleurs en essayant de créer des différences entre eux (notamment après les décrets de mars, utilisation des travailleurs de l’autogestion comme masse de manœuvre).
Encore marqué par des traces d’idéologie petite-bourgeoise, le PRS bien qu’il souligne que la ligne de démarcation passe entre le pouvoir d’une part et les masses de l’autre, concentre son tir sur Ben Bella, négligeant de désigner plus clairement les ennemis des masses. De même, si en ce qui concerne la construction du socialisme, le PRS se prononçait sans ambiguïté contre un socialisme spécifique octroyé par décrets ministériels et pour l’édification socialiste par les masses elles- mêmes, organisées dans des comités. Pour ce qui est du programme, il présentait beaucoup plus une série de mesures concrètes, un programme d’opposition qu’un ensemble de principes du mouvement révolutionnaire qui auraient fixé le contenu des classes qui doivent faire la révolution et celles qui doivent être renversées…
Le PRS parvint cependant à conquérir une certaine audience à travers le territoire, à maintenir une présence politique plus marquée, ce qui était facilité par le fait que, malgré les conditions de clandestinité, la direction du mouvement était àl’intérieur du pays.
Ces premiers résultats inquiètent le pouvoir qui, après avoir contre-attaqué sur le plan politique (le 1er Mai 1963 Ben Bella va jusqu’à proposer de transformer 1e FLN en front de la Révolution Socialiste), passe à la phase de répression. Boudiaf est enlevé en pleine rue en Juin 1963 et séquestré au fin fond du Sahara. D’autres personnes, qui n’appartenaient plus depuis longtemps déjà au Parti, sont aussi arrêtées. Une page est tournée. Une nouvelle période commence.
2 – Le FFS et la question de l’unité
En juin 1963, le PRS apparaît pour beaucoup comme étant un placement pour l’avenir, comme la seule force opposée à Ben Bella. Les éternels opposants (ceux qui avaient déjà tâté du PRS : chefs de willayas, responsables de l’ex-Fédération de France etc …) se manifestent de nouveau et des regroupements se font. Les arrestations visant notre Parti accélèrent le processus et cristallisent cette nouvelle opposition autour de Ait Ahmed qui fonde le FFS et passe à l’action armée le 29 septembre 1963.
L’échec du FFS fut lamentable et les négociations de novembre entre le pouvoir et les dirigeants du FFS eurent un seul résultat palpable : la libération des personnes arrêtées.
Dans la conjoncture qui avait présidé à la constitution du FFS, le PRS, bien que connaissant les tares originelles du mouvement, ne pouvait se tenir à l’écart sans devenir l’allié objectif de Ben Bella. il fut donc dans l’obligation de suivre le mouvement qui se consuma comme un feu de paille. Le seul résultat positif de cette aventure fut que notre parti eut la chance de se voir débarrassé de certains éléments « fatigués » qui à la sortie de prison, préférèrent se rallier au pouvoir ou, tout simplement, rester dans leurs pantoufles. Mais, la situation était loin d’être clarifiée. Une fraction du FFS refusant de tirer les leçons de l’échec récent, décida de continuer le combat et de relancer l’action armée au moment même où le PRS essayait de faire de son mieux pour aider ces camarades à se placer sur des positions correctes. La discussion engagée entre les militants sur la nature de l’unité fut escamotée. Bien que les pressions des partisans de l’unité à tout prix avaient déjà amené le secrétariat du PRS à suspendre ses publications pour éviter d’ajouter à la confusion, il n’y eut du côté du FFS aucune manifestation d’une volonté d’union bien au contraire il était décidé à faire cavalier seul. Le PRS en resta pour ses frais, tandis que Ait Ahmed multipliait les contacts en dehors de nous, pour relancer son mouvement, malgré la défection de certains militants.
3 – La naissance du C.N.D.R.
Les manœuvres reprenaient à Alger, les rumeurs circulaient, les contacts se multipliaient et, de nouveau, une atmosphère semblable à celle de l’été 1963 se recréait dans la capitale. Le PRS était l’objet de toutes sortes de sollicitations pour s’engager dans la construction d’un mouvement unitaire – certains intellectuels (Taleb Ahmed, Ait Challal) ajoutaient à la confusion en rejoignant opportunément les rangs des mécontents ; enfin et surtout, la répression en Kabylie prenait une tournure de plus en plus rude et l’ANP resserrait son étau sur les maquis du FFS. A Alger l’insécurité devenait grande pour nos militants dont certains étaient déjà connus des services de police. Au lendemain de l’attentat contre la villa Joly, Boudiaf dût quitter Alger et rentrer dans la clandestinité dans l’Est du pays.
La situation politique du pouvoir se détériorait. Chaabani entrait en opposition ouverte, tandis que le bruit courait que plusieurs officiers de l’ANP se désolidarisaient du pouvoir. Ajoutons à cela le mécontentement d’un peuple, lassé par les promesses du pouvoir dont les fissures devenaient béantes après l’élimination de Khider – secrétaire général du F.L.N. Tout autant de faits qui rendaient la situation explosive et nous entraînaient irrésistiblement vers une deuxième aventure.
Le congrès du FLN de 1964 ne pouvait rien régler et la crise du sommet battait son plein. Il apparaissait de plus en plus évident qu’une solution de rechange devait se dessiner. L’aboutissement de tout cela fut la création du CNDR (Comité National de Défense de la Révolution) qui eut pour effet immédiat et inattendu de restaurer l’unité factice du pouvoir et qui, en fin de compte, fut plutôt d’un grand secours pour Ben Bella.
Le CNDR était le type même d’alliance de sommet et, en tant que tel, il constituait un recul sur toutes les positions antérieures du PRS. Sa proclamation, signée de Hassani Moussa, est d’une grande banalité : typiquement petite-bourgeoise, sa forme grandiloquente cachait mal un vide politique effarant, ses principaux points étaient « libération des énergies saines » , « sauvegarde du patrimoine national », « stabilité politique », « relance économique et sociale », « rétablissement de notre prestige » (?) ; ses moyens d’action. devaient être la rébellion d’une partie des troupes de l’ANP du Constantinois, que la trahison de l’adjoint du commandant de région (Mohamed Rouge) remit en question. Ce qui fait que les « maquis » se constituèrent sans l’apport des militaires. Quant à Ait Ahmed, qui avait donné son accord pour la constitution du CNDR, il remettait tout en question en publiant quelques jours après une conférence de presse (?) datée du 6 juillet et dans laquelle il affirmait l’autonomie du FFS.
Tout s’écroulait. Les arrestations étaient nombreuses. Chaabani se fait arrêter et condamner à mort. A ce sujet, il serait bon de faire justice d’une certaine campagne de presse de la « gauche » qui vi- sait Chaabani dont elle faisait (après son passage à l’opposition) un réactionnaire de la pire espèce. Nous nous souvenons même d’un article du journal français « Libération », financé par Ben Bella et qui applaudissait à l’arrestation de Chaabani par un mauvais jeu de mots où il était question de «poisson dans l’eau » et de « poële à frire ».
A notre avis, Chaabani n’était ni plus ni moins réactionnaire que bien d’autres officiers algériens mais, certainement, bien plus courageux que beaucoup car il a payé de sa vie le droit de dire ce qu’il pensait.
Au.bout de quelques semaines, le CNDR se réduisit au seul PRS. Dès lors il s’agissait, pour nous, de sortir de ce guêpier et d’en tirer les leçons.
L’échec du mouvement de guérilla qui prit fin avec la prise de Aït Ahmed et le ralliement de Hassani Moussa ne signifiait pas pour autant la fin des difficultés pour Ben Bella. Les grèves du début de l’année 1965, le mécontentement populaire qui s’exprimait dans des manifestations spontanées, tout cela montrait l’aggravation de la situation. Isolé, Ben Bella tenta, dans un dernier effort, de renforcer sa position sur le plan international en mettant sur le chantier l’organisation de la « Conférence Afro-Asiatique » et, de réduire les oppositions en engageant avec elle des négociations. Des sondages sont entrepris en direction du PRS qui refuse de se rallier au régime et du FFS qui signe un accord avec le FLN le 16 juin 1965. C’est la fin du FFS et, trois jours plus tard, celle du règne de Ben Bella.
4 – La définition d’une stratégie correcte
le coup d’Etat de Boumédienne est un tournant. Il confirme les analyses du PRS et montre bien que le régime de Ben Bella a surtout permis à le nouvelle bourgeoisie de s’installer et le coup d’Etat marque le réajustement du pouvoir politique au pouvoir économique ainsi que la jonction de l’ancienne et de la nouvelle bourgeoisie.
Le 19 juin est aussi.un tournant pour l’opposition, car il provoque un tri puisqu’un mouvement de ralliement au régime s’opère et des individus, qui tournaient à la périphérie du parti, sautent dans le train, au bon moment cette fois.
Toutes les illusions petite-bourgeoises sont rejetées du parti et la nécessité de s’engager dans la construction du parti d’avant-garde devient impérieuse. La « deuxième lettre ouverte » de Mohamed Boudiaf esquisse une analyse de classe de la société algérienne. Elle tire les leçons des expériences passées, dénonce les mythes de l’union nationale, de la lutte armée et lance un appel pressant pour la construction du parti d’avant-garde ; première étape du processus révolutionnaire. Elle se prononce, d’une façon définitive, contre toutes les tentatives d’unification circonstancielles et contre les alliances de sommet. Enfin, elle précise le sens du travail à mener.
Dès lors, ce n’est plus qu’une question de temps pour se débarrasser des dernières séquelles de la période de confusion et donner au PRS le visage qu’il a maintenant. Cela ne signifie pas du tout que les discussions ont cessé dans le Parti, bien au contraire, elles ont été à la base d’une avance considérable sur le plan idéologique et d’un renforcement sur le plan organisationnel. Le PRS. n’a pas voulu s’enfermer dans un isolement sectaire. Il est resté ouvert à tous les contacts, fort de ses positions théoriques et de la justesse de ses vues. C’est ainsi qu’il faudrait dire un mot des discussions de 1966 avec l’ORP. Car elles nous ont permis de nous préciser par rapport au courant révisionniste. Bien que l’ORP se réclame de l’idéologie socialiste, les divergences entre nos deux mouvements étaient fondamentales.
En ce qui concerne l’analyse de la société algérienne, le régime benbelliste était selon l’ORP, une époque de transition vers le socialisme, alors que les faits ont prouvé qu’il s’agissait surtout d’une phase d’installation et de consolidation de la bourgeoisie bureaucratique. Le coup d’Etat du 19 juin n’est pas considéré comme un bouleversement fondamental (ce qui est juste) mais comme un accident de parcours (« une crise ») qui affaiblit momentanément l’aspect progressiste de l’Etat algérien.
Cette analyse (à rapprocher de la théorie révisionniste des deux aspects du pouvoir d’Etat sur laquelle nous avons eu l’occasion de revenir à plusieurs reprises) débouche sur le mot d’ordre de constitution d’un « front démocratique » rassemblant les révolutionnaires. Ainsi donc, la solution pacifique et démocratique à la crise ouverte le 19 juin se résume en la recherche d’un compromis, ou d’une occasion, pour retrouver un strapontin auprès du pouvoir. La lutte des classes, les masses populaires ne sont là que pour la figuration. Depuis lors, cette ligne opportuniste ne s’est pas démentie et elle continue d’être appliquée comme le prouve la récente lettre de Hadjeres à Boumedienne.
Il est clair que les raisons de cette politique de l’ORP doivent être recherchées dans deux faits :
- l’attachement à la politique dite de « coexistence pacifique » qui prône la stabilisation des luttes sociales dans le Tiers Monde et le statu quo, tout en essayant de modifier le rapport des forces en faveur de l’Union soviétique par une pénétration dans les pays dominés à travers des personnalités baptisées révolutionnaires (Ben Bella, Nasser, Soekarno …).
- la deuxième raison est le manque de confiance dans les masses populaires et la volonté de rechercher une place dans le pouvoir par le moyen d’obscures luttes d’appareils et de compromis. L’action des masses étant considérée comme un appoint lorsque la bourgeoisie met en doute La représentativité de ceux qui se présentent comme des défenseurs des travailleurs. Le résultat de cette position c’est que l’ORP refuse d’oeuvrer à la construction d’un parti révolutionnaire d’avant-garde. Son changement de sigle et la prétention qu’elle a depuis, d’être le parti d’avant-garde lui permet d’éviter justement de poser les problèmes de cette construction que le PRS considère comme la question principale du moment. Nos divergences avec l’ORP se sont manifestés à plusieurs reprises à propos de problèmes d’actualité. En particulier pour :
- les élections communales – alors que le PRS prône une abstention claire, sachant que les communes ne peuvent jouer aucun rôle car les leviers de commandes sont ailleurs – l’ORP élabore une théorie fumeuse qui prône la participation dans de nombreux cas à ces élections considérées comme un élément positif.
- le conflit algéro-marocain : l’ORP prends une attitude belliciste faisant l’amalgame entre peuples et pouvoirs et appelant les algériens à soutenir Boumedienne, elle va encore plus loin en demandant que les armements de l’ANP soient accrus (ce qui aurait augmenté par la même occasion la pénétration russe).
- le conflit du Moyen-Orient : l’ORP se fait le défenseur de la politique soviétique dont le lâchage spectaculaire a été ressenti avec émotion par les masses arabes et devient une fois de plus le défenseur des pouvoirs en place.
- sur le plan intérieur, la tactique employée en milieu étudiant et en milieu syndical aboutit à une démobilisation qui a toujours freiné le développement des luttes de masses : les éléments de l’ORP préfèrent toujours régler les conflits au niveau du pouvoir plutôt que de laisser se développer les luttes à la base.
- La politique économique du pouvoir est analysée comme étant un aspect positif alors, qu’à l’évidence, elle livre notre pays au pillage.
- enfin, dissociant la lutte anti-impérialiste de la lutte des classes l’ORP se laisse aveugler par les positions verbales de Boumedienne sans tenir compte de sa collaboration réelle de plus en plus étroite avec les trusts impérialistes.
5 – Le débat dans le parti et la définition de la voie révolutionnaire
En résumé, on peut considérer que les débats qui se sont déroulés au sein du parti, lui ont permis de mieux se définir et de préciser dans la marche son programme, sa ligne, sa stratégie, ses formes d’organisation en même temps qu’ils provoquent une épuration du contenu du mouvement lui donnant un caractère de plus en plus prolétarien.
5.1 – Premier débat : faut-il lutter de l’intérieur ou de l’extérieur ? Ce débat a permis de faire un premier choix entre la voix réformiste (entrisme) et la voix révolutionnaire. Il signifie, en fait, faut-il accepter le système et travailler de l’intérieur pour le réformer (et on sait qu’une telle attitude aboutit inévitablement à la défense du système) ou bien faut-il créer un mouvement qui se situe complètement en dehors du pouvoir sur un autre terrain ?
C’était là le premier choix : le PRS choisissait de créer un parti d’avant-garde des travailleurs, un parti de classe autonome.
5.2 – Deuxième débat, la question de la forme de la lutte : faut-il lancer un processus de lutte armée en espérant que les masses suivront et refaire le 1er novembre ou faut-il commencer d’abord par expliquer la situation c’est-à-dire faire un travail politique ? Le PRS réponds à cette question, il est nécessaire de faire un large travail de formation-information-animation au sein des masses, il faut se baser sur l’action des organisations syndicales, les appuyez dans leurs revendications, la lutte armée n’est qu’un moment de la lutte des classes. La poser comme un préalable, c’est escamoter le contenu du processus révolutionnaire (Parti ou Guérilla).
5.3 – Troisième débat : le problème de l’unité. Ce débat rejoint en un sens le précédent et s’est posé en même temps. Il est courant d’entendre dire que l’opposition algérienne est inexistante, qu’elle est incapable de développer une activité cohérente et positive, parce qu’elle est divisée. C’est là une façon erronée de poser le problème : car c’est un mythe réactionnaire que de prétendre à l’unicité de l’opposition au régime en place, il y a une opposition réactionnaire et une opposition révolutionnaire. Les mettre dans le même sac, c’est nouer des alliances circonstancielles en dehors des luttes de classes dans un but de prise de pouvoir (putschisme) La question n’est donc pas celle de l’unité de l’opposition, mais celle de sa consolidation idéologique et politique. Car une alliance de circonstance, même triomphante, ne résout pas les problèmes.
La prise du pouvoir n’est qu’une étape du processus révolutionnaire, elle est le moyen qui permet aux exploités de poursuivre une politique qui va dans le sens de leurs intérêts et qui, par conséquent, va contre l’intérêt de leurs exploiteurs.
Faut il un mouvement d’opposition ou faut-il un mouvement révolutionnaire ? Après avoir connu des périodes difficiles et d’hésitations le PRS a choisi résolument la voix révolutionnaire.
5.4 – Quatrième débat: le plus récent, il concerne essentiellement les tâches et les formes d’organisation. En posant les questions de la construction du parti d’avant-garde nous avons débouché sur les tâches qui elle-même nous ont amené à préciser nos conceptions de l’organisation et de la liaison avec les masses (voir le texte sur la positions du PRS).
Nous avons fait le bilan des année de lutte qui ont commencé avec la création du PRS le 20 septembre 1962. Se plaçant dans la lignée révolutionnaire algérienne du PPA du CRUA et du FLN–ALN du 1er novembre 1954, le PRS conscient du fait que l’indépendance nationale ne pouvait garantir la véritable libération et l’émancipation des masses laborieuse, s’était donné comme objectif d’entreprendre cette dernière étape sans quoi la dite indépendance pouvait se révéler plus nocive que le colonialisme lui-même.
La signification profonde du PRS reste que des militants révolutionnaires ont dit NON à la dictature d’une poignée d’usurpateurs et qu’ils continuent à dire NON à une politique qui nous fait perdre chaque jour une indépendance chèrement acquise. Il a placé sa confiance dans la capacité du peuple algérien à bâtir de ses propres mains son destin, à détruire les liens d’exploitation et à retrouver sa dignité en échappant à l’avilissement du sous-développement et de la domination.
Dans un monde déchiré par la lutte sans merci entre nantis et affamés, exploiteurs et exploités, oppresseurs et opprimés, chacun est mis en demeure de choisir son camp. Le PRS malgré des hauts et des bas, malgré des faiblesses dont il ne cesse de se corriger, a toujours opté théoriquement et pratiquement pour le camp des masses populaires contre les bourgeoisies intérieures et leurs maîtres impérialistes.
El Jarida n°7 – 20 septembre 1969